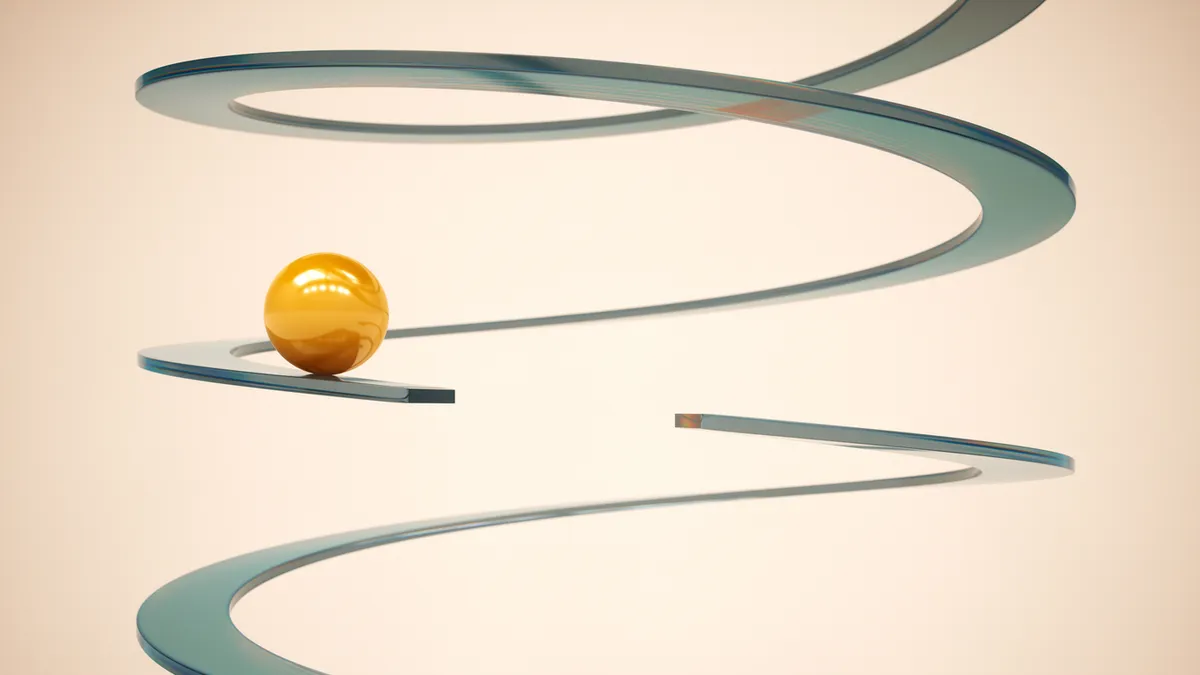« Jamais je n’ai reçu autant de pression, confinant à la menace, que de la part de certaines sociétés autoroutières. »
Dans son livre paru début 2025, d’où est extraite cette citation, l’ancien ministre des transports Clément Beaune se dit « fier d’avoir fait voter » dans le budget 2024 une nouvelle taxe visant principalement les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA). À cette époque, son homologue à l’économie, Bruno Le Maire, avait parlé pour la première fois de « surprofits ».
Dans cet épisode qui marque un tournant, l’État s’est attiré les foudres des autoroutiers. Mais les relations s’étaient déjà tendues les années précédentes, sous la pression accrue de l’opinion publique au fil des augmentations de péages et à l’approche de la fin des contrats historiques, que le RN ou LFI promettent régulièrement de renationaliser.
Une stratégie très offensive ces dernières années
Officiellement, les sociétés d’autoroutes font peu de lobbying, voire très peu. Vinci Autoroutes n’a pas de fiche à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). APRR (groupe Eiffage) déclare moins de 10 000 euros dépensés en 2024. Seule Sanef (filiale du groupe espagnol Abertis) déclare entre 75 000 et 100 000 euros mobilisés en 2023 et 2024 pour contrer la nouvelle taxe sur les infrastructures (TEILD) et peser dans le débat sur l’avenir du modèle. Entre deux et six fois moins que SNCF Réseau ou Aéroports de Paris. Sanef est aussi la seule à disposer d’une responsable des affaires institutionnelles – et vient d’en recruter une seconde. Des fonctions que l’on ne retrouve ni chez les sociétés d’autoroutes du groupe Eiffage, ni chez celles de Vinci. Les cabinets de conseil sont, eux, davantage utilisés pour la communication, nous explique-t-on.
Cela n’empêche pas les sociétés d’autoroutes de sortir les muscles. « La TEILD a été un épisode un peu dur [de nos relations avec l’État] », reconnaît un autoroutier. En plein examen du projet de loi de finances, à l’automne 2023, Sanef et les sociétés de Vinci et d’Eiffage – mastodontes du BTP – expliquent que l’État trahit leurs contrats en touchant à l’équilibre financier des concessions. Ils brandissent la menace de moindres investissements en France si la confiance était rompue. Ou de faire payer ce « risque d’instabilité » dans de futurs contrats.
Vinci Autoroutes va plus loin. Il durcit son jeu sur le terrain judiciaire, réclame un euro symbolique pour faute à l’État concédant, demande aux juges d’« abroger » l’agence de financement des infrastructures de transport, menace d’attaquer la double casquette du Conseil d’État devant la Cour européenne des droits de l’homme… L’entreprise utilise aussi les médias grand public pour agiter le chiffon rouge d’une hausse des péages de 5 %, si une nouvelle taxe voyait le jour. Le calcul est simple : la colère des automobilistes fera reculer le gouvernement. La méthode hérisse même certains concurrents, bien conscients que le sujet des péages, inflammable, peut se retourner contre eux. Et surtout que leur évolution, strictement encadrée, ne sera pas possible sans une décision de justice préalable.
« Avec Vinci, c’est toujours difficile. Ils ont une approche de menaces et de contentieux », souffle un interlocuteur dans une autre société d’autoroutes. Les rapports conflictuels et la pression, « ce n’est pas le genre de [notre] maison », assure un autre, qui dit privilégier la pédagogie concernant les hausses de tarifs.
« C’était une stratégie offensive et contentieuse très active, vraiment liée à Pierre Coppey plus qu’à Vinci », nuance un ancien du ministère des transports, évoquant l’ex-président de Vinci Autoroutes, débarqué fin 2024. « Nicolas Notebaert [qui a pris la direction de Vinci Concessions au même moment, ndlr] n’a pas la même communication », observe cet interlocuteur.
Une judiciarisation permanente
La judiciarisation des relations entre l’État et ses concessionnaires ne cessera pas pour autant. Quoi qu’en disent les autres sociétés, la « logique de conquérant » de Vinci sur ce terrain a pu servir leurs intérêts, reconnaît l’ancien salarié de l’une d’entre elles. « Elles s’abritent un peu derrière Vinci », confirme un juriste, spécialiste du secteur.
En 2024, toutes les sociétés d’autoroutes ont attaqué la TEILD en justice. Une stratégie classique et assumée : « On fait valoir nos arguments. Si ça ne marche pas, on continue sur le volet judiciaire », résume un représentant du secteur.
D’autres augmentations de taxes ont été contestées par le passé. Ces dernières années, les SCA ont même refusé de payer certaines contributions en attendant qu’un juge leur donne potentiellement raison. Une tactique qualifiée de « bras de fer » et de « prise d’otage » par une responsable de l’État.
« Je ne compte plus le nombre de conflits répertoriés dans mon petit tableau », résume aujourd’hui un fonctionnaire.
Après des défaites devant le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, APRR compte porter son recours contre la TEILD devant la Cour européenne des droits de l’Homme et la Commission européenne, a appris Contexte. Et ainsi emboîter le pas de Sanef qui, pour une fois, a dégainé la première, avec une saisine européenne dès 2024.
Trois sociétés, trois ambiances
« Chacun a sa couleur, mais globalement, on défend les mêmes positions », observe une source au sein d’une société d’autoroutes. « On a des différences de ton », mais les recours sont « coordonnés », ajoute-t-elle.
« En gros, on est raccord quand il s’agit de sauver notre peau, on n’est pas d’accord sur la méthode du rapport avec l’État », résumait un autre interlocuteur il y a quelques mois.
« APRR attaque quand c’est sérieux », observe une source ministérielle. D’ordinaire, Sanef est quant à elle vue comme la « bonne élève ». « Ils doivent aimer perdre de l’argent », ricanait il y a deux ans un concurrent, soulignant leurs profits moindres et leur ton plus conciliant envers l’État. « Ce n’est pas un groupe de BTP français, ça les met dans une situation un peu à part », observe un haut fonctionnaire.
La conférence de financement des mobilités, ouverte à Marseille début mai, donne aujourd’hui encore une illustration de ces différences d’approche entre les sociétés : « Sanef ouvre grand le panel de propositions [sur l’avenir du modèle autoroutier, ndlr]. Elle est prête à étudier des options. Vinci est extrêmement crispée. Eiffage a une position un peu plus discrète », commente un membre du comité de pilotage.
Selon nos informations, chaque société a demandé à être entendue séparément dans le cadre de cet exercice, laissant le soin à leur fédération, l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (Asfa), de défendre un « socle d’intérêts communs sur les péages et le modèle concessif ». Habitués aux coups de force des SCA, certains responsables ministériels voulaient les évincer du groupe de travail sur le financement des routes et l’avenir des autoroutes. « Il a fallu une réunion interministérielle pour que l’Asfa soit conviée », relate un dirigeant. L’association a finalement été jugée « incontournable » par Matignon, mais son poids est bien plus faible que celui des grands patrons en personne. Pour lui permettre de peser davantage dans le débat, Eiffage aimerait lui retrouver un président rapidement : elle n’en a plus depuis un désaccord, en 2020, entre les anciens patrons d’APRR, Philippe Nourry, et de Vinci Autoroutes, Pierre Coppey.
Des appuis politiques, surtout locaux
Les personnalités comptent. De toute évidence, l’arrivée d’Anne-Marie Idrac, ancienne secrétaire d’État aux transports, à la présidence de Sanef fin 2023 a été un atout pour le groupe espagnol. Dotée d’un riche carnet d’adresses, elle entretient de bonnes relations avec ses anciens homologues Dominique Bussereau, Clément Beaune ou encore François Durovray. Récemment s’est même réuni un « club des ministres des transports sympas », comme l’appelle l’un de ses participants, en présence du détenteur actuel du portefeuille, Philippe Tabarot. Le 12 juin à Bercy, dans le cadre de la conférence sur le financement des mobilités, Anne-Marie Idrac a bénéficié d’une tribune de vingt minutes sans interruption.
Mais ce sont surtout les élus locaux qui sont perçus comme des alliés potentiels par les SCA. En matière d’infrastructures, c’est à la porte des collectivités que les concessionnaires vont frapper, leurs projets étant le plus souvent vus comme des vecteurs d’attractivité économique. Au PS, quoi qu’en dise le groupe à l’Assemblée nationale, plusieurs élus locaux militent par exemple pour l’aboutissement de l’A69, à l’image de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.
« Les élus locaux ont toujours quelque chose à raconter en rapport avec les autoroutes », rapporte une source chez un concessionnaire. Une autre complète : « Il y a une dépendance à la route en France. Quand vous êtes élus, vous évitez de scier la branche qui vous permet de respirer. »
L’élu du Tarn Jean Terlier (EPR), devenu rapporteur de la proposition de loi visant à contrer la décision de justice du tribunal administratif de Toulouse contre l’A69, est quasiment devenu un porte-voix du concessionnaire Atosca.
Des proximités qui nourrissent parfois un sentiment de connivence entre les SCA et les politiques. Un soupçon de conflit d’intérêts a par exemple visé Jean Terlier début 2024, finalement écarté par le déontologue de l’Assemblée. Les quelques mois passés par Élisabeth Borne à la tête des concessions d’Eiffage lui ont aussi valu son lot de critiques quinze ans plus tard, lorsqu’elle est devenue première ministre.
En 2023, Anticor a déposé une plainte contre X pour favoritisme dans le contexte du plan de relance autoroutier de 2015, négocié par les cabinets d’Emmanuel Macron et de Ségolène Royal, alors ministres de l’économie et de l’environnement, dont les directeurs de cabinet étaient respectivement Alexis Kohler et Élisabeth Borne. « Je ne vois pas pourquoi ils nous auraient fait un cadeau. Nos négociations contractuelles sont dures, fermes. Chacun défend ses intérêts. Les cadeaux, c’est un mythe », s’agace un dirigeant autoroutier.
Des tractations derrière les détails techniques
Régulièrement, les SCA mettent en avant la sévérité de l’État concédant à leur égard, et la grande expertise de ses fonctionnaires et ingénieurs qui les « fliquent » au quotidien, selon un ancien salarié. Car, en parallèle des relations par médias ou juges interposés, les SCA ont des échanges constants avec la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM).
Lors de ces rendez-vous liés à l’exécution de leurs contrats, « le cadre normal des relations avec l’État, c’est le dialogue », explique une source chez Vinci Autoroutes.
Mais ces discussions ont parfois tourné à la querelle ces dernières années, à mesure que la fin des concessions approche. Des détails, comme le remplacement de grillages par exemple, ont pu donner lieu à négociation, raconte l’ancien salarié. Leurs contrats expirant en 2031 et 2032, Sanef et Escota (Vinci Autoroutes) viennent surtout de finaliser avec la DGITM plusieurs années d’échanges techniques pour établir leurs « programmes d’entretien et de renouvellement » (PER), fixant les travaux à réaliser afin de restituer le patrimoine en bon état. Là encore, des tractations ont eu lieu, par exemple sur l’évaluation des ouvrages d’art. À nouveau, les méthodes ont divergé face à l’État.
Pour préciser ce qu’est le « bon état », le contrat de Sanef a pu être modifié début 2023 après des échanges que la société a jugés « constructifs », même si Anne-Marie Idrac a évoqué, le 12 juin à Bercy, une administration « très dure » en affaires. « La DGITM apprécie les acteurs qui sont dans la discussion », rapporte un connaisseur de ces échanges.
Avec Escota, le dialogue s’est corsé. Son PER lui a été notifié, mais la société a refusé de signer un avenant sur le « bon état », en représailles à la mise en place de la TEILD. Eiffage, dont la première concession à prendre fin est APRR en 2035, a quant à elle d’ores et déjà pris contact avec la DGITM pour préparer le terrain. Elle est perçue comme un interlocuteur moins conflictuel que Vinci Autoroutes, mais un fonctionnaire se remémore tout de même un vieux conseil : « Quand tu fais une réunion avec Eiffage, tu cherches celui qui va se faire couillonner. Si tu ne le trouves pas, tu te barres ! »
Dans ces négociations, les aspects techniques sont laissés aux experts des SCA et de la DGITM. Mais d’après nos informations, les dirigeants des concessionnaires sont directement en contact avec les hauts fonctionnaires chargés des transports. « Est-ce que c’est du lobbying, est-ce que c’est une discussion entre un délégataire et son mandataire ? », s’interroge une source ministérielle. Ces échanges sont en tout cas une autre porte d’entrée pour le lobbying des SCA, et ne font l’objet d’aucune déclaration à la HATVP.